Mot-clé : ovins
HARIZONA Helminthoses – Actions pour le Raisonnement des Interventions dans les Zones Ovines de Nouvelle-Aquitaine
- Article actualisé le
Les résistances des parasites aux traitements se multiplient dans les élevages ovins allaitants et laitiers. Il est urgent de changer les pratiques de gestion pour préserver l’efficacité des médicaments et maintenir l’élevage au pâturage. Ce projet vise à co-construire avec les éleveurs et tous leurs conseillers, un protocole d’évaluation de l’efficacité de stratégies alternatives de gestion.
-
Élevage

Un élevage ovin au pâturage, source d’infestations parasitaires
En Région Nouvelle-Aquitaine, la très grande majorité des brebis sont conduites au pâturage, avec des temps passés à l’extérieur plus importants que dans le reste du territoire français. Cette utilisation soutenue du pâturage, encouragée par les attentes sociétales pour des raisons de développement de l’agroécologie et l’amélioration du bien-être animal, entraîne l’infestation des ovins par des parasites gastro-intestinaux. Ces infestations pénalisant les productions, la quasi-totalité des éleveurs administrent des traitements anti-parasitaires à leurs animaux.
Des résistances aux traitements qui se multiplient et un parasitisme en évolution
L’utilisation non raisonnée des anti-parasitaires internes a conduit à la sélection de nématodes gastro-intestinaux (NGI) résistants à ces produits dans le monde entier. En France, en 1998, une enquête dans les élevages ovins allaitants de l’ouest, avait montré l’absence de résistance des NGI aux lactones macrocycliques, mais une forte prévalence des résistances aux benzimidazoles et au lévamisole. Depuis, des signalements de résistances aux lactones macrocycliques ont été rapportés dans différentes zones du territoire, et en particulier en Nouvelle-Aquitaine. D’autre part, le changement climatique est susceptible d’entraîner des modifications des traits de vie des parasites (extension de la période d’infestation, accélération des cycles) en conjonction avec une modification des pratiques d’élevage (extension des périodes de pâturage par exemple). Si la pression parasitaire et la prévalence des résistances venait à s’accentuer de façon simultanée, les éleveurs pourraient se retrouver dans une situation d’impasse thérapeutique, avec pour seule issue de rentrer les animaux en bâtiment pour les soustraire au risque parasitaire.
Des changements de pratiques qui deviennent nécessaires et urgents
La réduction de l’utilisation de ces médicaments apparaît donc aujourd’hui nécessaire. La filière ovine et tous ses acteurs doivent s’engager dans des démarches permettant cette réduction tout en préservant les performances zootechniques et économiques des élevages, de façon à assurer sa durabilité et celle de l’écosystème de la filière.
La meilleure utilisation des AH, qui se traduira par une réduction, consiste à passer d’une utilisation systématique à une utilisation raisonnée qui s’appuie sur un ensemble de recommandations : bon diagnostic, connaissance du statut de résistance du troupeau, traitement à la bonne dose avec un médicament adapté et bien conservé, mise en œuvre du traitement sélectif, … Une autre façon de réduire l’utilisation des médicaments est de mettre en place une gestion intégrée du parasitisme en utilisant des méthodes complémentaires qui permettraient de réduire le niveau d’infestation et/ou de ralentir les cycles. Parmi ces méthodes, on peut citer des méthodes spécifiques de gestion du pâturage, la distribution de plantes riches en tanins condensés, la vaccination, la sélection d’animaux génétiquement résistants, …
Des stratégies de gestion intégrée à évaluer
Cependant, ces différentes stratégies n’ont été que peu ou pas mises en œuvre en conditions d’élevage, et encore moins de façon combinée, et aucune donnée sur leurs effets à moyen terme sur la consommation d’anthelminthiques et sur l’évolution de la résistance n’est disponible.
Le passage d’une stratégie simple de maîtrise, reposant sur une administration systématique de médicaments, à une stratégie de maîtrise plus complexe, associant un raisonnement de l’utilisation des anthelminthiques à des méthodes complémentaires, nécessite la formation des éleveurs et de leur environnement technique, avec une mise à disposition d’outils permettant de guider chacun dans des choix adaptés à son contexte et ses pratiques d’élevage.
Ce projet se propose de construire un protocole d’évaluation multi-disciplinaire des solutions de gestion intégrée du parasitisme gastro-intestinal. Cette construction nécessite la composition d’un groupe opérationnel rassemblant des éleveurs et l’ensemble des intervenants en élevage ovin, de façon à tester des solutions adaptées à la diversité des pratiques d’élevage ovin en Nouvelle-Aquitaine et à garantir l’adoption durable de pratiques validées et la transmission d’un message commun.
Objectifs
- Identifier les partenaires qui interviendront dans la phase d’évaluation : éleveurs, intervenants impliqués dans la gestion du parasitisme, partenaires intervenant dans l’évaluation des effets du changement de pratique (effets parasitologiques, zootechniques, économiques, effets sur le travail, sur la conduite de l’exploitation)
- Recenser les initiatives déjà existantes (en France ou à l’étranger), les caractériser et en évaluer les intérêts et les limites
- Construire le protocole d’évaluation de stratégies de gestion intégrée
Résultats
La réunion de lancement du projet Harizona a eu lieu le 30 janvier 2023. Cette réunion a regroupé tous les partenaires potentiels du futur projet. Elle a été l’occasion de mieux connaître chaque potentiel participant et de débuter les échanges sur les différentes actions qui pourront être incluses dans le futur projet.

Le 13 et 14 juin 2023, l’ANSES a participé aux Rencontres Nationales du Sainfoin qui avaient lieu à Troyes, organisées par la coopérative Multifolia et l’entreprise Mg2mix. Ces journées furent l’occasion de mieux comprendre la filière sainfoin et ses protagonistes, de recueillir les témoignages des utilisateurs de sainfoin et de réfléchir à comment cette plante pourrait être utilisée dans le cadre du projet Harizona.

La 2e réunion de projet a rassemblé tous les potentiels partenaires du futur projet le 19 juin 2023. Cette réunion a permis de définir plus précisément les actions qui vont composer les différents work-packages du futur projet..
Du 11 au 14 septembre 2023, l’ANSES a fait un voyage d’études dans la Loire et dans la Drôme pour y rencontrer des éleveurs pratiquant la gestion intégrée du parasitisme. Elle y a fait la rencontre de 7 éleveurs et éleveuses de brebis laitières, brebis allaitantes ou chèvres laitières très impliqués dans le dynamisme de leur territoire, et qui sont tous dans la démarche de mieux comprendre le parasitisme de leur troupeau et de protéger leurs animaux en utilisant mieux les molécules chimiques.
L’ANSES repart avec de nombreuses idées qui viendront nourrir la réflexion autour de la construction du projet HARIZONA, et notamment sur les méthodes complémentaires aux anthelminthiques qui seront proposées aux éleveurs.
Ce voyage a été permis grâce au Dr vétérinaire Michel BOUY qui a organisé les rencontres avec les éleveurs et éleveuses. Un grand merci à lui et à tous les éleveurs rencontrés pour leur accueil.





La réunion de clôture du PEI-Emergence a eu lieu le 15 septembre 2023. Cette réunion a regroupé tous les partenaires du projet qui sera déposé lors de l’appel à projet PEI-Fonctionnement. Elle a été l’occasion de présenter une première ébauche de la rédaction du protocole du projet HARIZONA, de discuter des rôles de chaque partenaire et d’évoquer les budgets. Elle a également permis de lister ce qu’il reste à faire avant le dépôt du projet.
INTER-AGIT + : Interactions entre Agriculteurs pour Gérer les Intercultures à l’échelle Territoriale pour des activités agricoles plus durables
- Article actualisé le
Accompagner les éleveurs, les céréaliers et les structures d’accompagnement pour permettre le développement du pâturage des intercultures au sein des territoires et favoriser une nouvelle forme de polyculture élevage durable.
-
-
Élevage
-
Grandes Cultures

Inter-AGIT+ complétera les connaissances sur les impacts agronomiques et zootechniques du pâturage des intercultures par ovins et bovins et lèvera les freins techniques, sociaux, économiques et juridiques qui limitent le développement de cette pratique.
Plus d’infos ici : https://idele.fr/interagit/
Objectifs
- Proposer des systèmes équitables, robustes et sécurisés intégrant des intercultures valorisables par la pâture,
- Élaborer des outils et méthodes participatives d’accompagnement de l’ensemble des acteurs favorisant les partenariats éleveur/céréalier au sein des territoires.
Résultats
Plus d’infos ici : https://idele.fr/interagit/
BREBIS_LINK – Dynamiser les territoires en créant du lien autour du pâturage ovin
- Article actualisé le
Ce projet repose sur l’étude des pratiques existantes, l’acquisition de références et l’élaboration d’outils d’aide au développement du pâturage sur cette mosaïque de cultures et de paysages qu’offre le grand Sud-Ouest.
-
Arboriculture
-
Élevage
-
Forêt
-
Viticulture
Le pâturage dit « additionnel » consiste en la valorisation par les brebis de la ressource fourragère
présente dans les vergers, vignes, couverts hivernaux, céréales, parcours boisés… toutes ces surfaces
cultivées ou en déprise qui offrent une ressource alimentaire supplémentaire aux brebis. Cette pratique
constitue une solution possible au développement de nouveaux troupeaux ovins et conforte les surfaces
en pâturage des élevages existants. Elle représente aussi une alternative à l’emploi de produits phyto-
pharmaceutiques, participant ainsi à la préservation de la qualité des sols et de l’eau. Enfin, ce mode
de fonctionnement peut être considéré comme une opportunité pour lutter contre la fermeture des
paysages et contribue à dynamiser les territoires par la création de liens entre ses différents acteurs et
usagers.
3 AXES DE TRAVAIL
• Repérer et analyser les pratiques locales sur des territoires du grand Sud-Ouest et identifier les facteurs favorables, les freins et les leviers potentiels.
• Tester ces pratiques afin de favoriser leur appropriation sur les territoires du projet. Il s’agit de mettre en place des dispositifs expérimentaux et de démonstrations, montrant aux éleveurs et cultivateurs comment les freins existants tels que les dommages potentiels sur les cultures ou la contrainte travail peuvent être levés. Il s’agit également de produire des références techniques permettant de rationaliser ces pratiques.
• Promouvoir le pâturage additionnel grâce à l’élaboration et la diffusion d’outils d’appui technique sur tous les territoires où ces pratiques trouvent leur intérêt. Cela passe par la formalisation de cadres juridiques et l’élaboration d’une méthode de mise en relation éleveurs-producteurs-collectivités.
Objectifs
• Un guide technique sur le pâturage des milieux étudiés
• Un recueil de recommandations pratiques sur le travail
• Des articles et journées techniques
Des outils de sensibilisation
• Des vidéos de sensibilisation sur l’intérêt du pâturage additionnel
• L’élaboration des modules pédagogiques à destination de l’enseignement
Des outils d'encadrement de la pratique
• Un guide de partenariat entre éleveurs et cultivateurs avec un modèle de convention
• Une méthode de mise en relation des acteurs locaux pour favoriser l’installation ovine et le développement du pâturage
Résultats
24_Elevage_Ovin_Fiche-technique_Brebis_sous_chataigniers 24_Fiche9_Brebis_Link_EffetTravail 24_Fiche-technique_brebis_dans-les-vignes 24_Fiche-technique_Brebis_Pension_hivernale 24_Fiche-technique_Surfaces_Pastorales 24_Fiche-technique-Brebis_CouvertsVegetaux 24_Fiche-technique-brebis-sous_noyers 24_Fiche-technique-brebis-sous-pommiers 24_Guide_Pastoralisme 24_Guide-du-partenariat-paturage-ovin 24_Mise_en_hivernage_Brebis FichePresentationBrebis_link-finale PlaqTemoignages_BL_OK
OtoP 3D
- Article actualisé le
Auto-pesée et imagerie 3D, deux outils de phénotypage à haut débit et d’aide à la décision en élevage ovin
-
Élevage

OtoP-3D ambitionne de valoriser l’identification électronique grâce à pour fournir aux éleveurs de nouveaux indicateurs de pilotage de leurs troupeaux afin d’améliorer leurs performances à l’aide d’outils simples d’utilisation, automatiques et adaptés aux contraintes technico-économiques des élevages ovins (troupeaux de grands effectifs, solutions peu coûteuses, …). Deux technologies sont en cours de développement dans le cadre de ce projet :
- L’auto-pesée pour un suivi continu du poids des animaux

- L’imagerie 3D pour une estimation de la Note d’Etat Corporel (NEC) des brebis tondues

Objectifs
- Mise au point du concept de l’imagerie 3D pour du phénotypage à haut débit sur brebis fraîchement tondues et sur agneaux
- Mise au point du concept de l’auto-pesée comme outil de phénotypage et de suivi du troupeau en analysant les données existantes puis en testant de nouve aux dispositifs de pesée
- Réponse aux besoins des éleveurs par une élaboration participative et la réalisation de dispositifs « à façon »
- Tests des deux dispositifs et étude de leur complémentarité en sites expérimentaux et lycées agricoles, et élaboration d’algorithmes de traitement de données fournissant des alertes pour aider à la conduite du troupeau
- Partage des résultats obtenus et garantie de l’interopérabilité entre les outils testés et les logiciels de troupeau
Paralut
- Article actualisé le
Associer la génétique et l’alimentation via des concentrés riches en tannins condensés pour limiter le recours aux anthelminthiques en ovins lait et ovins viande.
-
Élevage
L’objectif de ce projet est de limiter l’utilisation des anthelminthiques chimiques en ayant recours à la sélection de la résistance génétique et/ou à l’utilisation d’aliments à substances bioactives via un apport par le concentré à l’herbe. A plus long terme, la résistance aux strongles gastro-intestinaux pourrait intégrer les schémas de sélection et les « alicaments » seraient associés aux plans de rationnement des troupeaux ovins viande et ovins lait.
Objectifs
- Sélectionner des animaux génétiquement résistants au parasitisme par le phénotypage de béliers de races Manech Tête Rousse, Basco Béarnais, et Rouge de l’Ouest puis en mesurer les effets sur leurs filles en élevages,
- Mesurer l’efficacité de deux alicaments, les bouchons de sainfoin et les résidus de fruits (châtaigne et noisette) distribués au pâturage,
- Evaluer la faisabilité de la combinaison des deux méthodes (génétique et alimentation) en élevages,
- Diffuser largement les résultats obtenus et les conseils qui en découlent vers différents publics (éleveurs, techniciens, vétérinaires, enseignants, apprenants) et sous différentes formes.
Résultats
Lutte contre les strongles digestifs : Une nouvelle donne, de nouvelles pratiques, des perspectives prometteuses

Parasitisme : agir vite pour éviter l’impasse
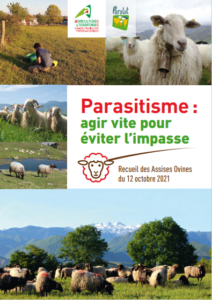
Sainfoin: des vertus antiparasitaires contre les strongles qui restent à démontrer
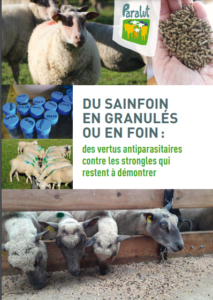
FASTOChe
- Article actualisé le
Tester et développer le pâturage des plantes riches en métabolites secondaires bioactifs dont les tannins condensés.
-
Élevage
Les traitements basés sur l’utilisation d’anthelminthiques de synthèse présentent plusieurs limites : des résistances de plus en plus prégnantes, des impacts environnementaux et des interrogations sociétales. Or, les strongles gastro intestinaux restent une pathologie majeure chez les ovins et caprins au pâturage. Ce projet a pour objectif de proposer aux éleveurs des solutions alternatives agro-écologiques basées sur le pâturage de plantes riches en métabolites secondaires bioactifs dont les tannins condensés.
Objectifs
1. Construire des solutions innovantes avec des groupes composés d’éleveurs et de techniciens afin de repérer les attentes et les besoins et de partager les acquis,
2. Mettre au point des pratiques de pâturage comprenant des plantes riches en métabolites secondaires bioactifs sur la base d’expérimentations en milieux contrôlés,
3. Intégrer les itinéraires testés et évaluer leurs intérêts à l’échelle des élevages pour définir des stratégies d’adaptation,
4. Diffuser largement les résultats obtenus et les conseils qui en découlent vers différents publics (éleveurs, techniciens, vétérinaires, enseignants, apprenants) et sous différentes formes.
Résultats
OVICARBONE
- Article actualisé le
Tester des solutions « bas carbone » pour réduire l’empreinte carbone de la viande ovine en Nouvelle-Aquitaine tout en assurant la durabilité de la filière.
-
Élevage

Face au défi du changement climatique, ce projet ambitionne de tester de nouvelles pratiques présentant un intérêt environnemental pour la filière ovine régionale. Il s’agit par exemple d’améliorer l’autonomie en fourrage des exploitations en pâturant des surfaces externes à l’exploitation ou encore d’augmenter la part de carbone stockée en développant les prairies permanentes et le linéaire de haies. Le plus large recours aux mélanges fermiers et aux légumineuses font partie des autres leviers testés. L’intérêt économique de ces pratiques est systématiquement évalué, au même titre que les performances des animaux.
Objectifs
• une étude sur un système d’élevage « bas carbone » mis en place au CIIRPO, sur sa ferme expérimentale du Mourier (87). Cette « mini-ferme » fait l’objet de nombreuses mesures afin d’obtenir des références environnementales, techniques, économiques et sociales,
• des essais comparatifs testant des pratiques « bas carbone » sur les deux exploitations de lycées agricoles de Bressuire (79) et Montmorillon (86), avec à titre d’exemples : des durées de lutte très courtes pour réduire le temps en bâtiment et les quantités de concentré ; l’incorporation de graines de soja dans un mélange fermier pour les agneaux.
Résultats
Grâce aux six leviers mis en place de 2021 à 2023 sur la mini ferme « bas carbone », l’empreinte carbone a été amélioré de 22 %.
Découvrez tous les résultats Doc_Ovicarbone-Web
Sous réserve d’être incorporées à moins de 20 % dans l’aliment des agneaux, les graines de soja crues peuvent se substituer aux céréales sans modifier les performances Fiche_graines de soja crues
Les critères de réussite des luttes naturelles de moins de deux cycles pour des brebis adultes ont été définies Doc_LuttesCourtes-Web






